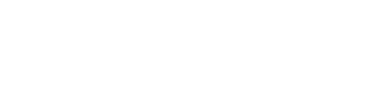Entretien avec Carlos Saboga
P.: Votre film précédent traitait des années 60/70, mais vues avec un regard actuel. Dans Photo, il y avait, en quelque sorte, un règlement de comptes avec l’Histoire récente du Portugal, en particulier avec la dernière décennie de la dictature fasciste. Maintenant, dans A Une Heure Incertaine, vous retournez plus en arrière, dans le Portugal salazariste de 1942, pendant la Deuxième Guerre Mondiale, à travers un film d’époque.
Pour paraphraser Alexandre O’Neill, le Portugal est un sujet, une question, qui vous hante ?
CS. : De toute façon, et pour continuer à paraphraser O’Neill, « il ne s’agit pas de remords ». En effet, si les deux films que j’ai réalisés se déroulent l’un et l’autre au Portugal, il me semble, qu’au fond, l’un comme l’autre questionnent l’époque plutôt que le pays. Si j’ai encore un questionnement par rapport au Portugal ce n’est certainement pas un problème d’ordre identitaire ou de règlement de compte. Ça l’a été. Mais après tant d’années de séparation, le Portugal est, pour moi, avant tout une langue et une mémoire. Je dois ajouter que je ne suis pas supporter de Benfica, et que le fado n’est pas, parmi d’autres, la musique je préfère.
P.: La question de l’exil forcé, ici au travers des deux réfugiés de guerre français, revient, cette fois de forme distincte.
CS.: Peut-être, je n’en sais rien, parce que l’exil, forcé ou choisi, est un point de départ intéressant en termes dramatique, qui permet à l’auteur un regard, disons, plus distant sur les deux marges, celle que l’on a laissé, et celle que l’on rejoint. Mais je suppose que l’autobiographie n’est pas tout à fait étrangère à cette attraction pour les exilés comme un vague parfum de désertion, de trahison, et même…. Le sentiment conséquent de culpabilité qui les ronge …
P.: Dans ce “monde fermé” où tous semblent cacher un secret, l’inspecteur Vargas finit par avoir un comportement différent que celui que l’on pourrait attendre d’un inspecteur en chef de la PIDE, contrairement à Jasmim, son subalterne. Ceci est-il dû au fait qu’il ait quitté le pays, pour combattre en Flandres pendant la Première Guerre Mondiale ? Celle que Laura appelle « L’autre guerre », et à quoi il répond qu’il n’y a qu’une seule guerre, continue, et aucun lieu sûr.
CS.: Je pense que Vargas est, après les deux français, le troisième exilé du film, latent, mais radical, parce qu’il ne croit même pas qu’il puisse y avoir un port d’abri possible. C’est un mort en suspens. Un « étranger ». L’expérience en Flandre, le souffle de la mort sur le champ de bataille, semblent l’avoir convaincu que la guerre est une condition inéluctable de l’homme. C’est probablement ce qui l’emmène à se renfermer par rapport aux autres. Et à ses sentiments.
P.: Ilda, la fille adolescente, a une énorme volonté de vivre, toujours attentive aux bruits, aux signes venant de l’extérieur. Simultanément, elle ressent une énorme passion pour son père, aussi physique et incestueuse, qu’elle révèle elle-même lorsqu’elle fantasme en lisant un épisode des Filles de Loth de l’Ancien Testament.
CS.: Ilda est l’opposé de Vargas. C’est sa seule vitalité, sa soif de reconnaissance de la part de son père qui fait avancer l’action. Ni la trahison, ni le crime ne la ferons reculer.
P.: Le titre du film, A Une Heure Incertaine, reprend en quelque sorte l'idée que le hasard finit souvent par avoir un rôle décisif dans la vie de chacun. Et que les vies se dénouent dans ces lieux de « passage, ou à mi-chemin » comme l’a été le Portugal pour les réfugiés de guerre à cette époque-là, comme l’est le passage de l’hôtel vers l’annexe, où le film se dénoue.
CS.: A vrai dire, le titre je l’ai piqué au poème de Primo Levi, Ad ora incerta, lui-même emprunté au proverbe latin Mors certa, hora incerta.
P.: Vous avez une œuvre longue et consacrée comme scénariste, et avez travaillé avec de grands réalisateurs. Vous disiez dans un entretien que souvent les scénaristes se sentent, en quelque sorte, frustrés car le résultat ne correspond jamais à ce qu’ils avaient idéalisé sur papier. Est-ce que entre le tournage et le montage de ce film, Carlos Saboga le réalisateur a effectué beaucoup de changements dans ce que Carlos Saboga le scénariste a écrit ?
CS.: L’écrit a été relativement modifié (la chair est faible)… L’esprit est demeuré inchangé. Je dois ajouter que, même avant d’avoir réalisé mon premier film, j’ai toujours considéré que les réalisateurs avaient totalement le droit de s’approprier ce qui était écrit. C’est la règle du jeu. En contrepartie, l’ignorance générale avec laquelle la critique contemple habituellement le travail du scénariste, me semble illégitime.
P.: Vous travaillez à nouveau avec Mário Barrosso, qui a également été responsable de la photographie dans Photo, et avec lequel vous avez travaillé comme scénariste, sur les deux longs métrages qu’il a réalisés, Um Amor de Perdição, adaptation contemporaine de l’œuvre de Camilo, et O Milagre Segundo Salomé, adaptation du roman de José Rodrigues Miguéis, sur le Portugal de la première république. La photographie est extrêmement importante dans la création de cette atmosphère oppressante que le pays vivait.
CS.: Je travaille avec Mário Barroso depuis la fin des années 70, si l’on compte les courts-métrages à moitié réalisés et les projets frustrés. Son rôle dans les deux films que j’ai réalisé a été essentiel.